Instruction en famille : en deux ans, le nouveau régime a fait fondre le nombre de demandes
Le nombre de demandes d'instruction en famille a considérablement diminué depuis que la loi exige une autorisation préalable et alors que le régime dérogatoire pour les enfants déjà instruits en famille a pris fin en 2024.
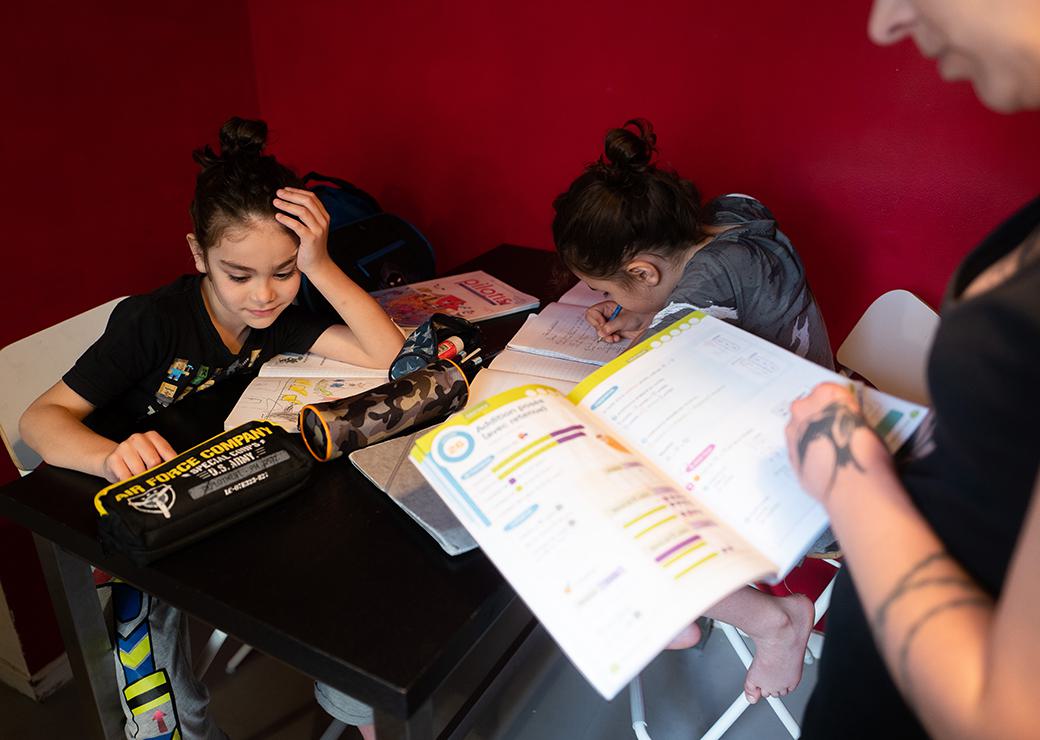
© Romain GAILLARD/REA
L'année scolaire 2024-2025 marque un tournant dans la nouvelle vie de l'instruction en famille (IEF) telle qu'elle résulte de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ce texte – qui a fait passer l'IEF d'un régime libéral de déclaration à un régime d'autorisation préalable – prévoyait, durant deux ans, une dérogation de plein droit à la demande d'autorisation pour les enfants instruits en famille en 2021-2022 et dont les contrôles pédagogiques étaient satisfaisants. Cette dérogation ayant pris fin après deux années, la campagne 2024-2025 s'est illustrée, d'une part, par une baisse significative du nombre de demandes d'IEF, et d'autre part, par une augmentation du nombre de recours devant les tribunaux administratifs, nous apprend la dernière Lettre d'information juridique du ministère de l'Éducation nationale.
Un tiers de demandes en moins
Le nombre de demandes d'IEF est ainsi passé de 60.638 en 2022 à 54.459 en 2023 puis 40.846 en 2024, soit une chute de 33% en deux ans. La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère commente ce chiffre en mentionnant que "cette évolution correspond à l'objectif fixé par la loi". Cette "évolution" n'a pourtant jamais été un objectif explicitement déclaré, la loi visant surtout à renforcer les contrôles de l'IEF afin de lutter contre les dérives sectaires ou communautaires. Ce n'est pas la première fois que l'administration fait référence à des résultats conformes à des "objectifs", ce qui a fait dire à l'association Liberté éducation qu'"il ne peut y avoir de politique de quotas en matière de droits fondamentaux" (lire notre article du 25 septembre 2024).
Alors que 80% des autorisations d'IEF en 2022-2023 et 66% en 2023-2024 étaient délivrées au titre du régime dérogatoire, seuls les motifs de droit commun peuvent désormais être invoqués en appui d'une demande. Il s'agit de l'état de santé ou du handicap de l'enfant (motif 1), de la pratique intensive d'activités sportives ou artistiques (motif 2), de l'itinérance de la famille en France ou de l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public (motif 3) et enfin de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif (motif 4). La DAJ précise que si tous ces motifs sont en augmentation, la hausse est de l'ordre de 90% à 139% pour les motifs 2, 3 et 4 par rapport à 2023-2024.
71% d'ordonnances judiciaires en plus
La fin du régime de plein droit – accordé à plus de 96% des demandeurs – a également eu pour effet mécanique d'augmenter le nombre des refus : plus de 9.000 contre environ 6.000 en 2023. Même si le taux d'acceptation des demandes fondées sur l'un des quatre motifs a légèrement augmenté : 77% en 2024 contre 74% en 2023.
L'augmentation du nombre de refus pour 2024-2025 s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de recours contentieux : 480 ordonnances de référé-suspension rendues par les tribunaux administratifs au titre de la campagne 2024-2025, contre 280 pour 2022-2023, soit une hausse de 71%. Les recours portant sur le motif 4 ("situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif") sont plus que jamais prédominants : 80% des ordonnances portent sur ce motif, contre 72% en 2022-2023.
À l'instar des campagnes précédentes, la DAJ relève "des disparités significatives dans la répartition géographique des recours". Les académies de Strasbourg, Rennes et Poitiers concentrant plus d'un quart des recours ayant donné lieu à une ordonnance de référé.
Enfin, la DAJ indique que 10% des ordonnances de référé ont décidé la suspension de l'exécution du refus d’autorisation et que 14% des jugements rendus au fond ont été défavorables à l’administration.


