Financement des infrastructures de transport : vers une loi-cadre en deux volets
Développement des modes collectifs et massifiés, priorité à donner à la modernisation et à la régénération des réseaux existants pour améliorer la sécurité et la performance des transports, renforcement du cadre pluriannuel de financement, utilisation du levier de la tarification des usagers, mobilisation d’une part substantielle des péages autoroutiers, à l’issue des concessions actuelles, pour financer les infrastructures de transports … : les conclusions de la conférence Ambition France Transports lancée le 6 mai dernier ont été remises ce 9 juillet par son président, Dominique Bussereau, à Philippe Tabarot, ministre chargé des transports. Celui-ci a annoncé qu’une loi-cadre sera élaborée avec les parlementaires et les participants à la conférence pour concrétiser ces orientations. Le premier volet de ce texte sera examiné "dès décembre prochain".
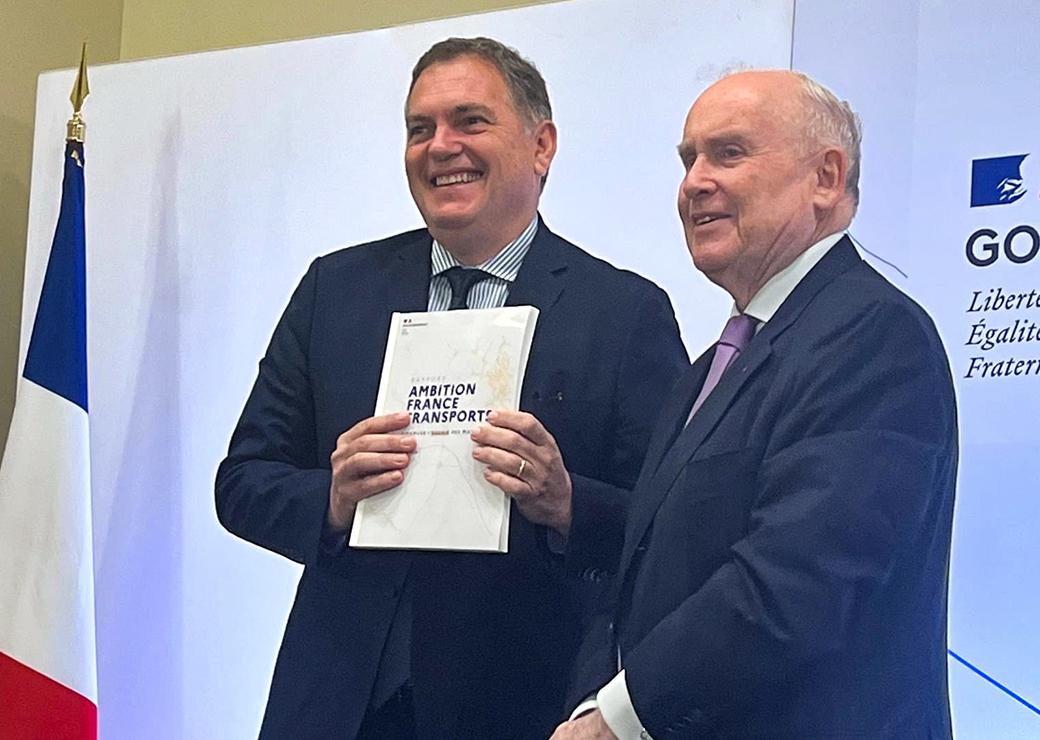
© @Dbussereau/ Philippe Tabarot et Dominique Bussereau
"C’est une nouvelle page de l’histoire de nos infrastructures de transport qui s’ouvre aujourd’hui", a déclaré Philippe Tabarot, en recevant ce 7 juillet à l’hôtel de Roquelaure, des mains de Dominique Bussereau, président de la conférence Ambition France Transports, le rapport produit à l’issue d’un travail de dix semaines mené par les experts, parlementaires, élus locaux et représentants de fédérations professionnelles ou d’usagers chargés de définir un modèle pérenne de financement du secteur des transports pour les vingt prochaines années. Le tout dans un contexte marqué par des défis croissants liés à la régénération et à la modernisation des réseaux – "après un sous-investissement de plusieurs décennies", a relevé Dominique Bussereau -, à la décarbonation des mobilités, ainsi qu’à l’augmentation de l’offre pour répondre à une demande en forte progression (+30% d’ici 2050).
"Boussole pour le gouvernement et les décideurs politiques"
Quatre groupes de travail thématiques ont été constitués dans le cadre de la conférence - modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et des services express régionaux métropolitains (Serm), financement des infrastructures routières, infrastructures et services ferroviaires de voyageurs, report modal et transport de marchandises. Au total, 110 auditions ont été menées et 234 contributions ont été recueillies via la plateforme en ligne dédiée.
"Nous avons souhaité que le rapport de synthèse puisse constituer une boussole lisible pour le gouvernement et les décideurs politiques, avec l’intime conviction que la décarbonation des transports et le développement des modes collectifs et massifiés participeront à la compétitivité de notre économie et au renforcement de la cohésion territoriale entre périphéries et grands centres urbains", a mis en avant Dominique Bussereau.
Consensus sur sept grands principes
"Les travaux ont permis de dégager un consensus sur de grands principes qui devront dessiner l’avenir du financement des mobilités", a-t-il poursuivi. Et de détailler ces grands principes : "l’importance du développement des modes collectifs et massifiés pour réussir la transition écologique, renforcer la cohésion des territoires et améliorer la résilience des infrastructures face au changement climatique" ; "la priorité renforcée aux investissements dans la performance et la sécurité des infrastructures existantes c’est-à-dire la régénération et la modernisation des réseaux" ; " la nécessité de renforcer et de sécuriser le cadre pluriannuel du financement des transports" ; "l’usage du levier de la tarification des usagers et des clients et l’optimisation des dépenses : maintien des péages autoroutiers, hausse différenciée des tarifs des transports collectifs, plus grande efficience des transports publics" ; "la réallocation d’une part de la fiscalité existante prélevée sur les transports vers ce secteur, la création de ressources nouvelles et davantage d’autonomie fiscale aux collectivités" ; "la mobilisation d’une part substantielle des péages autoroutiers à l’issue des concessions historiques pour financer les infrastructures de transport" ; " la mobilisation du financement privé lorsque cela est pertinent".
Trois milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an de 2026 à 2031
Concrètement, la conférence propose d’augmenter les investissements d’environ 3 milliards d’euros par an sur la période 2026-2031. Le réseau ferroviaire structurant pourrait bénéficier d’1,5 milliard d’euros supplémentaires par an à partir de 2028 pour les investissements de régénération et de modernisation, le réseau routier national non concédé d’1 milliard d’euros en plus par an afin d’inverser la tendance à sa dégradation et de commencer sa modernisation, le transport de marchandises de 500 millions d’euros supplémentaires par an afin d’accroître la performance et la résilience des infrastructures de fret ferroviaire et fluvial (300 millions d’euros/an pour le premier et 200 millions d’euros/an pour le second). La conférence suggère aussi de réaliser une revue générale des lignes de dessertes fines du territoire (LDFT) circulées pour préciser "les investissements nécessaires à leur entretien et clarifier la répartition de leur financement entre l’Etat et les régions", ainsi qu’un audit national de l’état du réseau routier départemental et communal structurant, en complément des travaux réalisés par le CEREMA sur les ponts des communes.
Nouvelles ressources à saisir
Pour "renforcer la contribution des usagers et des clients, en prenant en compte l’acceptabilité", elle propose d’augmenter progressivement la tarification des transports en commun tout en mobilisant la tarification solidaire ou encore d’"élargir à d’autres collectivités [que la collectivité européenne d’Alsace, ndlr] les expérimentations en matière de mécanismes d’écocontribution territoriale sur les poids lourds et/ou mettre en place des majorations ciblées des péages lourds sur les autoroutes concédées qui font face à des congestions importantes". Autres mesures préconisées : réallouer une part plus importante de ressources existantes prélevées sur les transports depuis le budget général de l’État vers l’Agence de financement des infrastructures – Afitf (TICPE, TSBA, création d’une dette spécifique pour résorber la "dette grise" du routier national non concédé) et allouer des ressources nouvelles prélevées sur les transports à l’Agence (système d’échange de quotas carbone ETS 1 et 2, hausse du malus poids, suppression progressive à horizon 2030 du taux réduit de TICPE, taxe sur la livraison de colis à domicile en zone urbaine).
D’autres ressources spécifiques à certains modes de transport pourraient aussi être mobilisées sans passer par l’Afitf – certificats d’économies d’énergie (CEE), ressources propres au ferroviaire (fonds de concours de la SNCF, recours à l’emprunt, cession d’actifs de la SNCF) et au fluvial (redevance hydraulique). Pour renforcer et diversifier le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité locales (AOM), le rapport propose de s’appuyer sur le déplafonnement du versement mobilité et/ou de "diversifier les recettes sur lesquelles repose leur modèle économique (taxe foncière additionnelle, taxe régionale additionnelle sur les certificats d’immatriculation, nouvelle redevance spécifique pour financer les services de transport)". Il souhaite aussi mobiliser l'investissement privé pour certains projets, propose de "saisir l'opportunité de l'arrivée à échéance de 90% des concessions autoroutières entre 2032 et 3037 pour revoir la gouvernance du système autoroutier" et "affecter le surplus de ressources issues des autoroutes à l'issue des concessions historiques en priorité vers la régénération et la modernisation des infrastructures nationales de transport".
Un projet de loi-cadre inspiré des travaux de la conférence
"Le gouvernement portera un projet de loi-cadre au Parlement qui sera préparé cet automne et présenté en décembre, en associant les parlementaires, et au premier chef ceux qui ont participé à la conférence", a annoncé Philippe Tabarot dans son discours de clôture de la conférence.
Ce texte devra définir "les nouveaux équilibres de financement des infrastructures de transport" et "donner un cadre d’actions à l’administration" en répondant à la fois "à l’impératif écologique" - les transports demeurant le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France et le plus en retard dans la décarbonation -, et "à l’impératif budgétaire de réduire le déficit public sous la barre des 3% en 2029". Dominique Bussereau a précisé lors d’une conférence de presse les principes d’action qui seront intégrés dans le projet de loi-cadre. À commencer par "le fléchage des recettes des nouvelles concessions autoroutières vers les transports au nom du principe de solidarité", un fléchage qualifié d'"historique" et d'"avancée majeure de la conférence" par Philippe Tabarot.
Ces financements ne seront toutefois pas disponibles avant 2032, date des premières arrivées à expiration des principales concessions. Ils monteront ensuite en puissance jusqu’en 2036 pour atteindre 2,5 milliards d’euros supplémentaires par an. Les péages, qui seront maintenus, continueront ainsi de financer les investissements indispensables à l’entretien des autoroutes, ainsi qu’à leur adaptation aux enjeux du changement climatique et au développement de la multimodalité tout en contribuant également à l’entretien des autres réseaux - ferroviaire, routier non concédé et fluvial.
L’objectif est également de "remettre l’État au cœur du dispositif autoroutier après son désengagement en 2005", en signant "des concessions d’une durée moins longue", avec "un encadrement renforcé de la rentabilité", "une réorganisation géographique des lots" et des "clauses de révision systématiques tous les cinq ans".
Pour le ferroviaire, le texte fixera "dans le marbre de la loi" l’objectif de 1,5 milliard d’euros supplémentaire par an affecté au réseau à compter de 2028, a affirmé Philippe Tabarot. "C’est historique, c’est une première", a-t-il souligné.
Travail d'identification des grands projets prioritaires de transports confié au COI
Ce projet de loi-cadre sera complété par un autre projet de loi qui identifiera "les grands projets prioritaires de transports", avec "tels types d’aménagements et tels financements", a poursuivi le ministre. Ce travail d’identification a été confié au Conseil d’orientation des infrastructures (COI) qui vient d’être installé, pour "vérifier la cohérence des projets" avec les priorités de "décarbonation", de "sécurité" et d'"adaptation au changement climatique".


