Les transports collectifs gagnent des parts de marché sur la voiture en France, selon l'ART
La part de voyageurs empruntant les transports collectifs en France, en particulier le train, a augmenté par rapport à ceux empruntant la voiture en 2023, tandis que la fréquentation des vols intérieurs a poursuivi son déclin, selon le quatrième rapport multimodal publié par l'Autorité de régulation des transports (ART) ce 1er juillet.
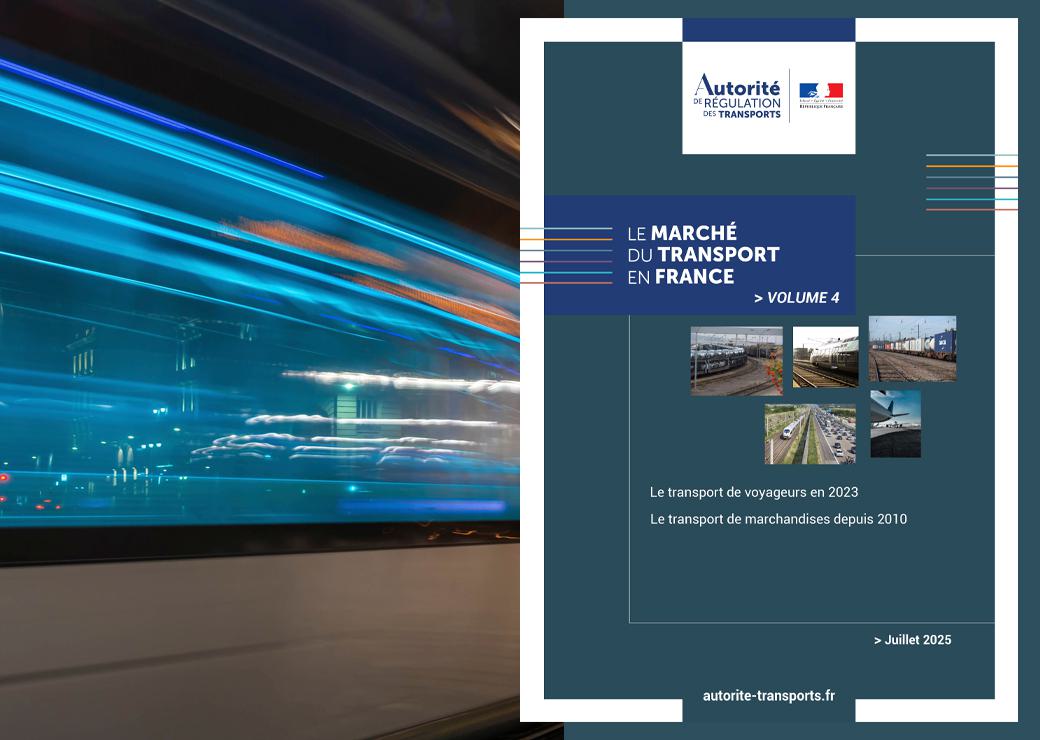
© ART et Adobe stock
"En 2023, le transport de voyageurs en France a connu une légère baisse de 0,3% par rapport à 2022, avec un total de 1.035 milliards de voyageurs par km", constate l'Autorité de régulation des transports (ART) dans son quatrième rapport multimodal publié ce 1er juillet. "Cette baisse s’explique principalement par la diminution des déplacements en véhicules particuliers, tandis que la demande en transports collectifs a augmenté", indique l’ART.
Hausse de la fréquentation des trains
La voiture reste privilégiée pour 82,1% des déplacements mais l'utilisation des transports publics augmente, gagnant 1,1 point sur un an à 17,9%, grâce principalement à la fréquentation des trains, TGV comme régionaux (TER). La part de voyages effectués en train atteint 10,4%, soit une hausse de 0,5 point par rapport à 2022. "Sur les déplacements de plus de 100 km, la fréquentation des trains à grande vitesse a ainsi dépassé le trafic en voiture sur autoroutes concédées" en nombre de voyageurs par km, a souligné l'ART.
À rebours de l’international, le transport aérien intérieur a, lui, poursuivi son déclin, perdant 2% de voyageurs en 2023 par rapport à l'année précédente. La fréquentation sur ce type de liaison est en retrait de 14,3% depuis 2017.
Les prix "moyens" du transport intérieur (lire aussi notre encadré ci-dessous) varient toujours significativement selon les modes, en 2023. À 5,2 euros par passager pour 100 km de trajet, la voiture reste le moins onéreux, à condition d'emprunter les routes sans péage. Les trajets en autocar librement organisé ou en train à bas coûts (Ouigo) reviennent à un peu moins de 7 euros aux 100 km et à 11,80 euros pour les TGV classiques. À plus de 23 euros pour les vols domestiques des compagnies classiques, l'avion est le plus cher des moyens de transport (23,1 euros) mais reste plus compétitif que le train pour un grand nombre de trajets internationaux vers les pays voisins. À l’exception du transport ferroviaire, pour lequel l’essor des services à bas coûts a limité pour le moment la hausse des prix, les prix augmentent plus vite que l’inflation pour les autres modes depuis 2019.
Dégradation de la qualité des services de transport
L’ART relève que la qualité des services de transport s’est de nouveau dégradée en 2023, avec des taux d’annulation en augmentation, dont près de 4 points pour les lignes TER de longue distance, et des taux de retard en augmentation pour la quasi-totalité des modes, dont une hausse de 5 points pour les vols domestiques. Selon l’Autorité, la hausse des annulations s’explique majoritairement par des mouvements sociaux, tandis que les retards sont multifactoriels, incluant des défaillances liées aux infrastructures, matériels de transport ou induites par des causes climatiques.
Léger recul des émissions de gaz à effet de serre
Avec 122 millions de tonnes d’équivalents CO₂, dont 94% proviennent du transport routier, les émissions de gaz à effet de serre des transports ont légèrement reculé en 2023 (-2%). Ce secteur reste le premier contributeur aux émissions de CO₂ en France (34% du total) mais son impact environnemental a légèrement diminué entre 2022 et 2023, souligne l’ART, qui l’attribue aux effets d’une baisse des kilomètres parcourus par les véhicules particuliers et à l’électrification accrue du parc automobile. Le transport ferroviaire affiche pour sa part les émissions les plus faibles (moins de 1% des émissions globales), "car 84% des trains.km de voyageurs et 75% des trains.km de fret sont réalisés en traction électrique", explique l’ART qui estime que "doubler la part du fret ferroviaire pourrait ainsi contribuer, d’ici 2030, à réduire de 3 à 4 millions de tonnes d’équivalents CO₂, soit près de 10%, les émissions liées au transport de marchandises."
Transport de marchandises : renforcement du mode routier
Le rapport de l’ART, qui comporte pour la première fois une analyse multimodale du transport de marchandises en France montre cependant qu’il y a encore beaucoup à faire pour renverser la vapeur. Alors que le transport intérieur de marchandises a stagné en France, entre 2010 et 2023, oscillant autour de 330 milliards de tonnes.km, avec une faible dynamique sur les flux domestiques comme internationaux, la domination historique de la route sur ces deux flux s’est renforcée depuis 2017, observe l’ART. "Les modes ferroviaire et fluvial n’opèrent plus en 2023 que 10% et 2% respectivement des flux intérieurs de transport de marchandises, précise-t-elle. Par ailleurs, en 2023 comme auparavant, le trafic fret se concentre sur une partie des infrastructures ferroviaires, routières et fluviales, reflétant l’importance prise par les trafics internationaux."
Les modes de transport ferroviaire et fluvial présentent toutefois des potentiels de développement, estime-t-elle. Avec près de 50% du fret international transitant par les ports maritimes, les modes ferroviaire et fluvial atteignent, pour les desservir, une part modale supérieure à leur moyenne nationale (22,7 % des acheminements maritimes), constate l’ART. Selon elle, cette part pourrait encore s’accroître "en renforçant la coordination avec les autres modes et en profitant de la forte dynamique du transport combiné qui augmente régulièrement et représente près de 40% du fret ferroviaire en 2023". "Le train pourrait également augmenter sa part modale sur certains segments de marché pour lesquels il a déjà montré sa pertinence et sa compétitivité (transports de longue distance, transport de pondéreux…), poursuit-elle. Dans la perspective d’un trafic de marchandises stable dans les années futures par rapport à son niveau actuel, les objectifs de doublement (entre 2021 et 2030) de part modale du fret ferroviaire ne pourront se réaliser qu’à partir de gains de parts de marché sur les modes concurrents", souligne-t-elle.
› Le train moins cher que l'avion en France, sauf en cas de correspondanceSe déplacer en train en France revient en moyenne moins cher qu'en avion, sauf correspondance, selon une étude de l’UFC Que choisir publiée ce 3 juillet. L'association de défense des consommateurs s'est intéressée aux tarifs des trajets ferroviaires, aériens et routiers en France, en prenant comme base les 48 liaisons aériennes les plus fréquentées du pays et suivant deux scénarios types : "un départ en vacances estivales pour un couple ou une famille avec deux adolescents, et un week-end pour deux adultes". "Le train se montre compétitif lorsqu'il existe des liaisons ferroviaires directes, notamment sur les axes radiaux (depuis ou vers Paris). Dans le scénario estival, 60% des trajets sont moins chers en train qu'en avion. Sur ces liaisons, le train est en moyenne deux fois moins cher que l'avion", selon l'UFC. "À l'inverse, dans le premier comme dans le second scénario, de nombreuses liaisons transversales (province à province), surtout quand un changement de train est nécessaire, s'avèrent moins chères en avion, de 37% en moyenne", précise l'association. "Quant à la voiture, elle est surtout attractive dans le scénario familial : un tiers des trajets y sont les moins chers, par rapport au train et l'avion, de 30% en moyenne en comparaison du train et de 44% en comparaison de l'avion." "Pour faire du train une (option) alternative réellement accessible et universelle", l'UFC-Que Choisir préconise entre autres de "renforcer l'offre ferroviaire", notamment transversale, d'augmenter à 4 heures le seuil d'interdiction des vols intérieurs lorsqu'un trajet alternatif ferroviaire existe, contre 2 heures 30 actuellement, de "mettre en place des tarifs avantageux pour les familles" ou encore de "renforcer les moyens de l’Autorité de régulation des transports dans le suivi des pratiques tarifaires des transporteurs ferroviaires". En pleine urgence climatique, l'UFC rappelle que "sur longue distance, le train est de loin le mode de transport le plus vertueux, en citant l'Ademe : "Un trajet en TGV n'émet en moyenne que 2,9 grammes de CO2 par passager-kilomètre, contre environ 331 g pour l'avion de courte distance et jusqu'à 256 g pour une voiture utilisée en solo (128 g pour deux passagers et 64 g pour quatre passagers)". Dans un document publié le même jour, le Réseau Action Climat (RAC), citant un rapport de Greenpeace attendu cet été, a élargi la problématique aux liaisons européennes, où "le train est en moyenne 2,5 fois plus cher que l'avion", une "aberration totale" selon le groupe. "Sur la liaison Paris-Rome, qui transporte plus de 2 millions de passagers aériens chaque année, le billet d'avion le plus bas se trouve autour de 70 euros en moyenne, contre 210 euros pour un billet de train", note le RAC. Ce dernier, pour rééquilibrer la concurrence, plaide pour "la fin des niches fiscales aériennes" en augmentant la taxe sur les billets d'avion à un niveau qui compenserait l'absence de taxe sur le kérosène. Le RAC voudrait ainsi financer la subvention d'un billet de train par an à tarif réduit (29 euros aller-retour) pour "tous les Français", relancer "vraiment" les trains de nuit, en particulier les liaisons entre les régions (par exemple, Marseille-Nantes, Lyon-Bordeaux, Nice-Strasbourg), et abaisser les péages ferroviaires pour le TGV, qui réduisent sa compétitivité, "à commencer par les liaisons internationales et transversales (région-région)". |


