Adapter les territoires et leurs infrastructures aux changements climatiques
Les inondations, les incendies, les cyclones sont les conséquences directes du dérèglement climatique sur nos territoires. L’adaptation des infrastructures devient vitale pour mieux gérer et anticiper les risques, et proposer aux populations un cadre de vie sécurisé et pérenne. Zoom sur les solutions proposées par la Banque des Territoires pour accompagner les porteurs de projets.

© AdobeStock - Maarten Zeehandelaar
Des infrastructures mises à mal par le dérèglement climatique
Le dérèglement climatique affecte tous les territoires avec des risques spécifiques à chaque région :
- intensification des feux de forêts provoqués par les sécheresses dans le sud de la France ;
- augmentation des risques de crues ;
- accroissement des inondations et des submersions côtières ;
- hausse des températures, entraînant des vagues de chaleur et des îlots de chaleur dans les grandes villes ;
- réduction de l’enneigement en montagne ;
- amplification des cyclones dans les DROM-COM.
Si le climat continue de s’emballer, ce sont plus d’incendies, une intensification de l’érosion du trait de côte sur le littoral, des submersions engendrées par la montée des eaux, moins d’enneigement en montagne, des sécheresses et davantage d’inondations qui seront à déplorer.
Certaines infrastructures territoriales, vieillissantes par endroits, n’ont pas été conçues en anticipation de ces catastrophes.
De nombreux bâtiments sont inadaptés aux fortes chaleurs : leur mauvaise isolation et des matériaux vieillissants occasionnent une surconsommation d’énergie l’été pour pouvoir refroidir les locaux. Ces infrastructures sont aussi une source d’inconfort voire un danger pour les populations accueillies, comme les enfants dans les écoles ou les personnes âgées en hôpital et en EHPAD. Il en va de même pour les revêtements utilisés pour construire les chaussées et les voies ferrées qui se déforment lors des fortes chaleurs, provoquant des perturbations majeures sur le trafic. Les pluies torrentielles saisonnières mettent aussi à l’épreuve nos infrastructures : les sols bétonnés n’absorbent pas l’eau, occasionnant des inondations qui fragilisent les zones submergées.
Les catastrophes naturelles révèlent la vulnérabilité et la primordialité de ces infrastructures. La tempête Alex, qui a frappé la Vallée de la Roya en octobre 2020, en est un exemple frappant. Cette catastrophe a provoqué de fortes inondations dans les communes de Tende, La Brigue, Saorge, Fontan et Breil-sur-Roya. Les pluies torrentielles ont entraîné la crue du fleuve Roya, dévastant des infrastructures vitales pour la vie quotidienne des habitants, telles que les routes, les ponts, les bâtiments et les réseaux d’eau potable. Le bilan a été lourd :
- plus de 2 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits ;
- plus de 50 km de routes ont été ravagés ;
- des centaines de kilomètres de réseaux d'eau potable et d'assainissement ont été anéantis.
Face à cette catastrophe, l'objectif de la reconstruction était double : non seulement restaurer ces infrastructures, mais aussi intégrer des solutions visant à renforcer la résilience du territoire face aux futurs événements climatiques.
Dans les DROM-COM, les systèmes de télécommunication aériens révèlent également leur vulnérabilité face aux tempêtes. En 2023, les tempêtes Ciaran et Domingos laissaient 385 000 Français sans téléphone pendant plusieurs jours, par manque d’alimentation électrique des antennes relais.
Face à ces défis croissants, les infrastructures doivent s’adapter pour garantir l’habitabilité et le bon fonctionnement de nos territoires.
Comment préparer nos territoires au changement climatique ?
Les territoires ont un double objectif : atténuer les impacts du changement climatique et s’adapter à ses conséquences. L’atténuation a pour but de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. L’adaptation consiste à réorganiser les infrastructures et les territoires, pour mieux gérer les effets du dérèglement climatique. Cela passe par la rénovation des bâtiments, la renaturation des villes pour lutter contre les îlots de chaleur ou la désimperméabilisation des sols contre les inondations.
Il est nécessaire de travailler territoire par territoire, pour que chacun élabore un schéma local de résilience. Il faut identifier quels sont les risques, où ils se situent et quelles solutions apporter.
Pour faire face aux nouveaux défis environnementaux, le développement d'infrastructures résilientes est prioritaire. C'est notamment le cas de celles liées au cycle de l'eau qui doivent évoluer afin de réduire notre dépendance et vulnérabilité. La création de zones d'expansion des crues ou de systèmes de stockage d'eau pour les périodes de pluie illustrent la volonté de favoriser la gestion partagée et anticipée de cette ressource essentielle.
Ces adaptations sont non seulement une demande croissante des citoyens, qui aspirent à des infrastructures pérennes pour travailler, étudier, se soigner et se déplacer, mais elles sont aussi guidées par des mesures nationales. Parmi celles-ci figurent : la planification écologique, le PNACC 3 (le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 3) et la loi Climat et Résilience de 2021.
L’adaptation au changement climatique : un impératif qui rencontre encore certains freins
Plusieurs obstacles freinent la mise en application de l’adaptation au changement climatique. « Nous sommes au début de la prise de conscience, explique Laurence Roux, responsable ingénierie territoriale en charge du plan d’action changement climatique pour la Banque des Territoires. Les politiques s’intéressent à l’atténuation, mais pas encore suffisamment à l'adaptation. »
Le principal frein rencontré est l'absence de modèle économique. Par exemple, la renaturation dans les écoles est pensée pour le bien-être des enfants, mais on ne pense pas à viabiliser le projet.
Autre frein à l’adaptation : le coût financier. Si nous reprenons le cas des infrastructures numériques, une solution pérenne pour leur protection consiste en l’enfouissement de l’ensemble des lignes, ce qui représente une dépense conséquente pour les territoires. À titre d'exemple, le projet Tintamarre à Saint-Martin, lancé après l'ouragan Irma en septembre 2017, a permis la reconstruction des infrastructures numériques souterraines de l'île, via un investissement de 600 k€ en capital, 1,26 M€ en avances et 6,5 M€ en subventions.
Cet investissement majeur n’est pas toujours considéré comme prioritaire, surtout en temps de crise bien qu'il représente un enjeu de résilience qui impacte directement les conditions de vie des populations. Il représente, de plus, un facteur d’attractivité pour les investisseurs et opérateurs, rassurés par la mise en place de dispositifs préventifs dans les zones à risques.
La Banque des Territoires aux côtés des porteurs de projets
Les acteurs de cette adaptation - collectivités locales, entreprises, organismes de logement social, aménageurs et citoyens - ont besoin d’être accompagnés pour aménager leur territoire de manière durable et efficace. La Banque des Territoires soutient la conception de trajectoires d’adaptation via :
- l'ingénierie, pour soutenir la conduite du changement et la gestion de projets complexes et multi-acteurs ;
- les prêts (prêts transformation écologique et prêt cohésion sociale) pour financer des projets de sécurisation, d’adaptation de bâtiments vulnérables au changement climatique, la constructions d’infrastructures résilientes mais aussi la reconstruction d’infrastructures après une catastrophe naturelle ;
- l'investissement en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises publiques locales ou entreprises innovantes engagées dans cette démarche d’utilité publique.
La Banque des Territoires accompagne les projets en proposant des solutions financières, institutionnelles et politiques. L'objectif est d'articuler les différentes échelles de temps et territoriales pour intégrer pleinement l'adaptation dans les pratiques et la gestion urbaine. Qu'il s'agisse de la gestion pré-crise ou post-crise, l'accompagnement par la sensibilisation, la formation et le soutien à la conduite du changement est un pilier essentiel pour assurer la pérennité des projets.
Aujourd'hui, on en fait moins que ce que l'on voudrait : nous faisons surtout des prêts en réaction, mais pas forcément en anticipation. L'objectif est d'inverser la tendance.
Les solutions concrètes pour adapter les infrastructures au changement climatique
À Moliets-et-Maa, en Nouvelle Aquitaine, la Banque des Territoires a soutenu la transformation du cœur de la station balnéaire 4 saisons. Un prêt d’un million d’euros sur 25 ans a pu être débloqué pour financer la désimperméabilisation des sols et la création de voies douces sécurisées pour protéger le littoral.
En 2024, dans la commune corse de Costa Verde, un Aqua prêt de 300 000 € sur 25 ans a permis de financer des infrastructures de prévention des inondations. Dans les Hauts-de-France la même année, à Saint-Michel, c’est la requalification et la renaturation de la friche commerciale Leblond qui a permis de transformer cet espace en lieu de résidence et en espaces verts, avec la création d’une formation boisée autour de sources d’eau. Pour ce projet, un prêt de 300 000 euros sur 25 ans a été accordé par la Banque des Territoires.
De nombreuses solutions existent pour adapter les infrastructures territoriales au changement climatique. Pour les collectivités, le principal défi des prochaines années sera de s’emparer de ces sujets pour proposer aux habitants des bâtiments résilients et des cadres de vie attractifs.
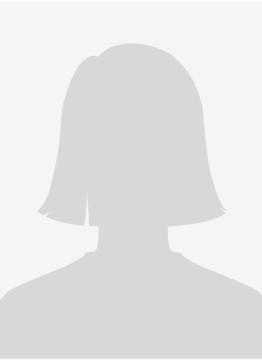
© Banque des Territoires
Alexandra Greenwood
Responsable du pôle Doctrine et Analyse projets à la Direction des Prêts du groupe Caisse des Dépôts
Titulaire d'un Master 2 en Droit de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, Alexandra Greenwood exerce depuis quinze ans au sein du Groupe Caisse des dépôts. Elle a notamment occupé la fonction de juriste pour la filiale CDC numérique, puis Investisseur au sein de la Banque des Territoires. Depuis bientôt trois ans, Alexandra a rejoint la Direction des Prêts dans laquelle elle développe l’offre de prêts du Secteur Public Local.

