Un guide pour concilier paysage et transition énergétique
Le réseau des grands sites de France publie un guide méthodologique pour "concilier paysage et transition énergétique". Ses recommandations, tirées d'expérimentations conduites depuis 5 ans par certains sites de son réseau, intéresseront l'ensemble des territoires, qu'ils soient ou non situés dans le périmètre d'un "grand site".
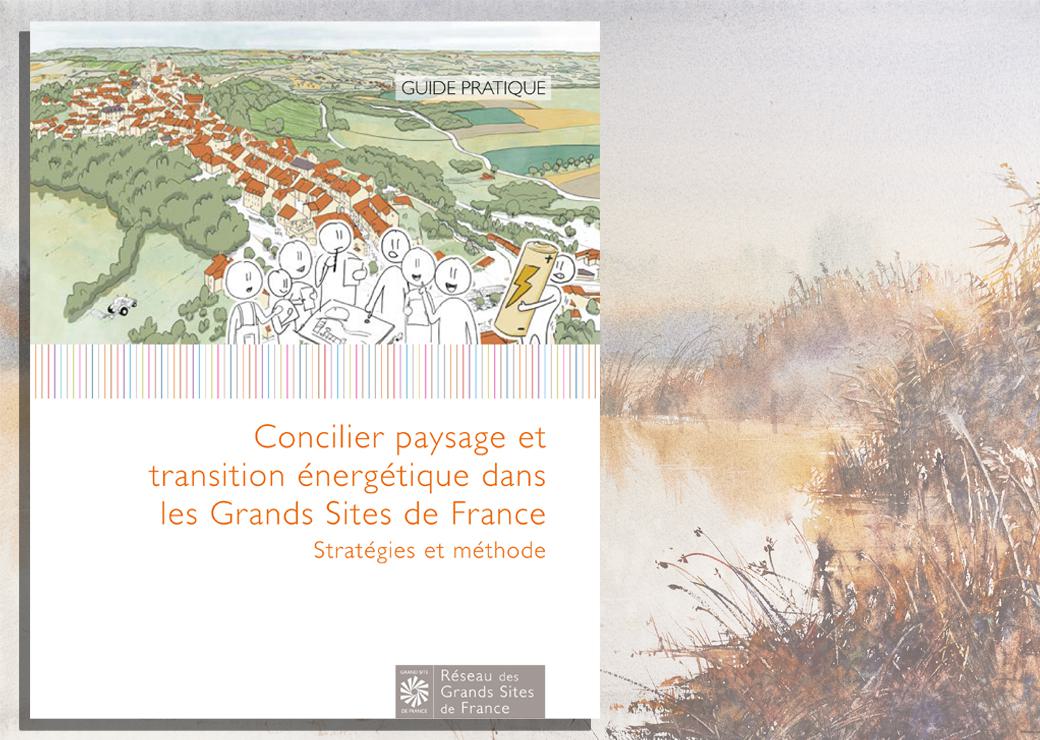
© Réseau des Grands Sites de France et Adobe stock
Face à la multiplication "des projets éoliens industriels", et plus largement à "une politique énergétique imposée aux territoires qui ne prend pas véritablement en compte les enjeux paysagers", le réseau des grands sites de France avait, en 2018, sonné l'alarme. Il avait alors pris officiellement une position (actualisée en 2023) pour, entre autres, que "le paysage soit reconnu comme un facteur majeur d'appréciation des choix à opérer" en matière énergétique. L'appel n'avait pas résonné dans le vide, puisque le ministère chargé de l'environnement proposait l'année suivante au réseau de conduire une expérimentation "Paysage et transition énergétique dans les grands sites de France" – avec un volet national et un volet local, conduit par des "grands sites" volontaires –, dont les acteurs viennent de tirer les premiers enseignements – et des recommandations – dans un guide pratique récemment publié. Avec l'objectif d'une solution gagnant-gagnant, alors que, selon le ministère, 70% des contentieux relatifs à des projets éoliens seraient fondés sur un motif paysager.
Ingrédients classiques de la réussite…
Le guide détaille pas à pas la marche à suivre : de la commande (pour élaborer la "stratégie paysagère de transition énergétique", laquelle peut notamment s'appuyer sur différents outils, comme un "plan de paysage transition énergétique" – lire notre article du 23 avril dernier –, une "aire d'influence paysagère" ou encore une "charte paysagère et architecturale") au programme d'actions, en passant par le diagnostic et les objectifs.
Plusieurs recommandations, génériques, ne surprendront guère – elles ne sont d'ailleurs pas sans recouper celles émises naguère par le réseau Cler pour "accorder EnR et patrimoine culturel" (lire notre article du 12 février dernier). Ainsi : de la nécessité d'un "portage politique fort" ; de "l'implication constante de la maîtrise d'ouvrage" ; d'une définition des besoins "précise et réalise" ; de la coordination des acteurs ; de la bonne détermination de la gouvernance du projet – ce qui n'est pas ici chose aisée, tant elle doit tenir compte d'un "écosystème de gouvernances" déjà particulièrement fourni : EPCI qui réalisent les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et documents d'urbanisme, communes qui définissent les zones d'accélération de la production d'énergies renouvelables (EnR), Dreal, Ademe régionale, chambre d'agriculture, DDT, unité départementale de l'architecture et du patrimoine, parcs naturels régionaux, etc. – ou encore de la définition du "cadre de la participation". Non sans souligner que cette dernière est difficile à maintenir dans la durée compte tenu "de la complexité du sujet qui demande un fort investissement de chacun".
… ou de l'échec
De même, la liste des difficultés rencontrées est somme toute classique. Parmi elles, le manque de culture commune initiale, le manque de temps, des moyens contraints impliquant des arbitrages (un budget compris entre 100.000 et 120.000 euros HT est recommandé pour un plan de paysage de transition énergétique, et un budget moyen de 80.000 euros HT est jugé nécessaire pour une aire d'influence paysagère) ou encore l'insuffisance de l'approche territoriale. Le document met notamment en garde contre l'utilisation de données ne correspondant pas toujours aux réalités locales, en prenant l'exemple de plans de paysage transition énergétique "généralistes" s'appuyant sur le scénario de l'institut négaWatt (lire notre article du 20 octobre 2021), en observant en outre que les "conséquences spatiales" du parti pris de ce dernier (exclusion de la production nucléaire) "n'ont pas toujours été clairement explicitées". Une difficulté également induite par la formulation d'objectifs de qualité paysagère de transition énergétique souvent "trop générique" et "manquant d'ancrage". Un souci "d'ancrage territorial" à relever, alors que le réseau s'était, en 2020, opposé à la déconcentration totale des autorisations de travaux en site classé, projet un temps abandonné mais tout récemment remis à l'ordre du jour (lire notre article du 2 juillet dernier).
Des enseignements spécifiques, un bilan positif
Le guide permet néanmoins de mettre en lumière des écueils plus spécifiques, comme la place trop importante prise précédemment par les énergéticiens dans l'animation des échanges ou le fait qu'experts paysagers et énergétiques ont peu l'habitude de travailler ensemble, peuvent insuffisamment prendre en compte la dimension patrimoniale des paysages ou manquer – on y revient – d'une approche territoriale de la transition énergétique.
In fine, le réseau tire un bilan "positif" de ces expérimentations. Il estime qu'elles "ont contribué à changer de paradigme en profondeur", en permettant notamment une prise en compte plus importante de la sobriété – et d'"un large mix d'énergies renouvelables" –, des spécificités paysagères ou encore des préoccupations des habitants et des acteurs locaux. Il juge encore que la démarche paysagère a permis "la mobilisation de ressources paysagères et énergétiques peu mises en avant par la planification nationale ou par les développeurs" ainsi que "la prise en compte d'une 'limite paysagère', s'inspirant des limites planétaires".
"Un écosystème qui doit encore mûrir"
Pour autant, il estime que cet "écosystème doit encore mûrir". Le réseau plaide, entre autres, pour le renforcement du cadre réglementaire et méthodologique national, la consolidation des moyens et compétences mises à disposition des territoires ou encore la création, la vulgarisation et mise à disposition de ces derniers et des autres acteurs "de données énergétiques utiles à la prise de décision".
Pour le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de la Transition écologique, "de nombreuses pistes de réflexion qui ressortent de ces travaux méritent d'être approfondies". Et de citer "la prise en compte des enjeux paysagers très en amont des projets de production d'énergie renouvelable, dès le choix de leur implantation" et "l'intégration de critères paysagers aux documents d'urbanisme et aux PCAET", qualifiée de "préalable essentiel pour garantir l'acceptabilité" des projets.


