IA générative : entre gains réels et risque d'automatisation de la complexité administrative
Une enquête de l'Institut Montaigne, menée sur huit mois auprès d'une centaine d'agents de la sphère étatique, montre que l'intelligence artificielle générative transforme le travail administratif de manière contrastée. Si les gains de productivité sont parfois spectaculaires, la technologie pourrait aussi "automatiser la complexité administrative" sans en tirer le pouvoir transformateur.
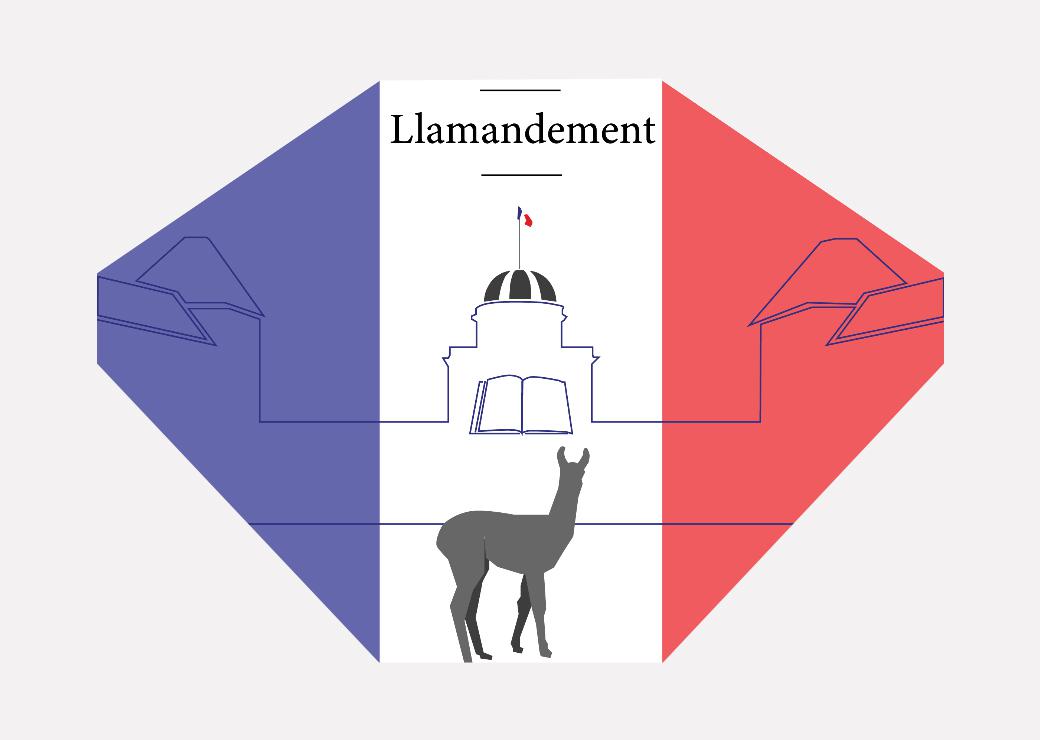
© DGFIP
En à peine deux ans, l'IA générative s'est diffusée rapidement dans les administrations françaises. Au-delà des annonces et des statistiques d'adoption, l'institut Montaigne a voulu savoir ce que les agents faisaient réellement avec ces nouveaux outils. L'enquête a été menée par Alexandre Meyer, ingénieur des Mines, durant huit mois avec 100 entretiens semi-directifs et quatre immersions au sein d'administration centrales et déconcentrées.
Foisonnement d'outils et shadowIA
Premier constat : les initiatives foisonnent au sein de l'État. À la direction générale des finances publiques, LlaMandement résume et analyse les amendements budgétaires. Le ministère des Armées a déployé GenIAl, celui de l'Intérieur MirAI quand France Travail utilise ChatFT pour libérer du temps aux conseillers, tandis qu'Albert assiste les agents des maisons France Services dans leurs réponses aux usagers.
Ces applications ciblées sont cependant l'arbre qui cache la forêt des usages de l'IA générative. Car les administrations de l'État n'échappent pas au "shadow AI", l'usage d'outils comme ChatGPT sans cadre officiel. Un phénomène qui témoigne d'un "appétit pour l'innovation" autant que d'une "absence d'espaces de discussion collectifs", interprète l'auteur.
Adéquation fonctionnelle et réhumanisation
Ensuite, si l'IA générative connait un fort développement dans l'univers administratif, c'est que l'administration "bat au rythme des mots", observe l'étude. Notes, rapports, circulaires, courriels… Les agents soumis à une "forte intensité textuelle" mobilisent l'IA pour produire des documents standardisés, générer des synthèses, rechercher de l'information dans des corpus éclatés, traduire, transcrire des réunions ou encore rechercher des idées.
Les gains peuvent être spectaculaires. La DGFiP a traité les 5.400 amendements au projet de loi de finances 2024… en 15 minutes, contre plusieurs dizaines d'heures auparavant. Sur la plateforme Services Public+, 68% des usagers jugent "utile" une réponse rédigée avec l'aide de l'IA (puis validée par un agent), contre 57% pour les réponses entièrement humaines. Les agents relèvent des formulations plus polies et des contenus plus riches, l'IA s'appuyant sur des bases de connaissances officielles.
Paradoxalement, l'IA aurait aussi des effets de "réhumanisation". À France Travail, la retranscription automatique des échanges via ChatFT Écoutes permet aux conseillers de se concentrer sur ce que dit l'usager plutôt que sur la prise de notes. "Avant, cela ressemblait à une déposition dans un commissariat", témoigne un agent. Le regard et la parole redeviennent centraux.
Effet rebond, homogénéisation et risque d'automatiser la complexité
Mais les gains de l'IA n'ont rien d'automatique et l'étude identifie plusieurs risques. D'abord, un "effet rebond" : parce qu'il devient plus facile de produire des contenus, plus de contenus sont produits... Cette inflation textuelle - plus de notes, d'e-mails, d'amendements ou de réponses aux appels d'offres… - est susceptible d'annuler les gains de temps initiaux.
Ensuite, l'homogénéisation voire la perfection formelle des réponses, peut s'avérer problématique. La standardisation des contenus appauvrit la diversité des styles et des approches, créant une suspicion croissante : "Cette note a-t-elle été rédigée par ChatGPT ? A-t-elle été relue ? Est-elle fiable ?" Dans une sphère administrative où l'écrit est la pierre angulaire de la confiance, cette incertitude "fragilise les repères collectifs" note l'étude. Plus insidieux, le risque de "paresse intellectuelle" avec un agent pouvant être transformé en simple relecteur passif. De fait, le travail ne disparaît pas, il se déplace en allant de la production vers la curation, la spécification des besoins (l'art de prompter) et le contrôle qualité. Mais sans formation ni cadre, cette transformation peut se faire à l'aveugle.
En définitive, le risque principal est celui du "pansement technologique". L'IA pourrait être mobilisée pour compenser la lourdeur des processus existants, sans transformation structurelle, se bornant à automatiser la complexité. Pire, dans certains cas observés, l'IA "se parle à elle-même" : des entreprises l'utilisent pour générer des réponses volumineuses aux appels d'offres, l'administration l'emploie pour les filtrer et les évaluer. La même dynamique s'observe pour les amendements parlementaires. "Quel intérêt à utiliser l'IA pour analyser des amendements eux-mêmes rédigés par l'IA ?" interroge l'étude.
Les cinq conditions d'une transformation réelle
Pour que l'IA générative devienne un véritable levier de transformation, l'étude identifie cinq conditions. Elle doit d'abord servir à simplifier réellement les procédures, et non pas à automatiser une complexité inchangée. Ensuite, elle doit libérer du temps pour recentrer les agents sur leur métier : accueil, accompagnement, décision. Troisième condition : être mobilisée dans un contexte maîtrisé par les agents, capables d'en contrôler la qualité, et non subie comme une "boîte noire" imposée. L'outil doit permettre à l'administration de remplir pleinement son rôle là où une surcharge l'empêchait, avec des délais contraints et des moyens limités. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, son déploiement nécessite une coconstruction avec les agents et les usagers. L'étude incite à créer des espaces d'expérimentation et une gouvernance plus horizontale en prenant du temps pour identifier des cas d'usage utiles en phase avec les réalités professionnelles.
"L'IA générative ne transforme pas le service public : elle agit comme un révélateur et interroge la capacité de l'administration à se transformer", conclut Alexandre Meyer.


