Coût de dépollution de l'eau : les collectivités en première ligne, alerte l'UFC-Que Choisir
Pesticides, nitrates, "polluants éternels" : le coût de la dépollution de l'eau promet d'exploser dans les prochaines années, s'alarme ce 18 novembre l'association UFC-Que Choisir. Selon elle, collectivités et consommateurs ne doivent pas supporter seuls l'augmentation de la facture d'eau.
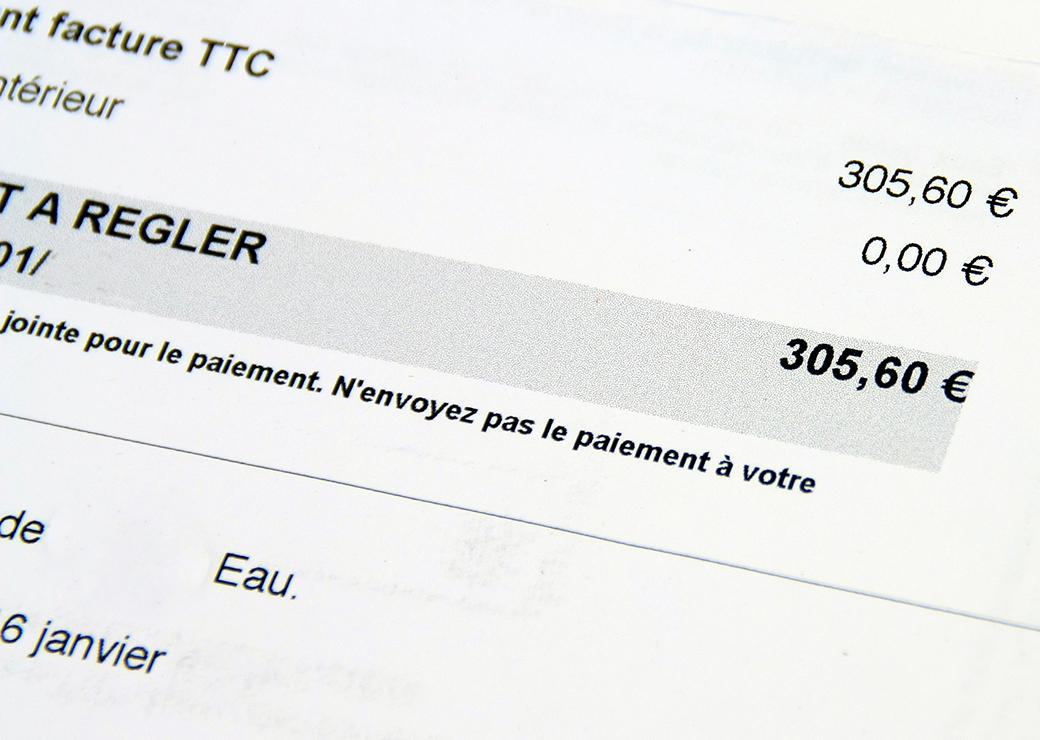
© Adobe stock
La part des réseaux où l'eau potable est conforme à la réglementation est en recul, selon une étude de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir dévoilée ce 18 novembre, le jour même de l’ouverture du Salon des maires où le coût de la gestion de l'eau figure au programme de nombre de conférences.
"Seulement 85% des réseaux sont conformes à l'ensemble des critères réglementaires, soit un recul de 10 points par rapport à la précédente enquête de 2021", s'inquiète l'étude, qui s’appuie sur les résultats de 30 millions d'analyses réalisées pour le compte des agences régionales de santé (ARS). Or, lorsque la limite de qualité (0,1 microgramme par litre pour un pesticide, 0,5 pour l'ensemble des pesticides détectés), est dépassée, l'eau est déclarée "non conforme", et le gestionnaire de la distribution de l'eau "a alors l'obligation de prendre des mesures pour rétablir la conformité de l'eau dans les meilleurs délais", souligne l'UFC-Que Choisir.
Hausse du prix de l'eau
Se fondant sur des données de l'Insee, l’association estime que ces contaminations "commencent déjà à se répercuter sur le prix de l'eau", le prix moyen du mètre cube ayant "augmenté de 16%" ces 30 derniers mois, "alors qu'il était particulièrement stable depuis les 10 années précédentes". Une étude publiée fin 2024, financée en partie par le ministère de la Transition écologique, estimait à 13 milliards d'euros les dépenses supplémentaires qu'il faudrait engager chaque année pour la politique de l'eau, dont 5 milliards rien que pour les coûts environnementaux.
Cette dégradation depuis 2021, provoquée essentiellement par les pollutions aux pesticides, n'est pas due à une évolution des pratiques agricoles, mais "essentiellement" à la "détection de nouveaux métabolites (molécules issues de la dégradation) de pesticides par les ARS depuis 2023", note l'association. Les métabolites de trois pesticides sont désormais recherchés dans l'eau du robinet : ceux de la chloridazone, un herbicide utilisé dans la culture des betteraves interdit depuis 2021, du chlorothalonil, un fongicide interdit en 2020 et de l'alachlore, un herbicide utilisé notamment dans la culture du maïs, interdit depuis 2008.
Dépassements de la norme dans plusieurs villes
Autre enseignement de l'étude, alors que jusqu'ici les dépassements de la norme sur les pesticides "ne concernaient que de petites communes rurales", désormais des villes comme Reims, Beauvais, Caen, La Rochelle ou Calais sont également touchées.
"Est-ce-que je peux continuer à boire mon eau ? La réponse est oui, dans la très grande majorité des cas", a déclaré à l'AFP Olivier Andrault, chargé de mission Alimentation et Nutrition à l'UFC-Que Choisir. Il rappelle que les valeurs réglementaires qui sont ici dépassées, ont été fixées "très, très bas en application du principe de précaution", et que les seuils de dangerosité de l'eau "sont en général beaucoup, beaucoup plus haut".
Davantage de coûts de dépollution à financer
Mais le coût de la dépollution risque de s'accentuer. Les techniques classiques de dépollution par charbon actif sont inefficaces sur les nouveaux métabolites, ainsi que sur de nombreux "polluants éternels" ou PFAS (pour substances per- et polyfluoroalkylées), dont certains seront recherchés systématiquement à compter du 1er janvier 2026. Les investissements dans des techniques comme la filtration membranaire, qui se chiffrent en milliards d'euros, sont supportables pour de grandes structures comme le Sedif (Syndicat des eaux d'Ile-de-France), compte tenu du large bassin de population concernée et des "économies d'échelle", mais "que vont faire les petites collectivités ?", s'alarme Olivier Andrault. Une interrogation qui vient en écho des inquiétudes des maires de villages des Ardennes et de la Meuse, qui se disent "abandonnés" par l'État, après la découverte l'été dernier de taux records de "polluants éternels" dans l'eau du robinet.
L'UFC-Que Choisir demande notamment un "renforcement des procédures d'autorisation des pesticides", des "mesures préventives de protection des captages" et "une aide ciblée aux petites communes grâce à un relèvement de la redevance pour pollution diffuse" acquittée par les agriculteurs. Un dossier que l'ancienne ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, avait indiqué souhaiter rouvrir, quelques mois avant la démission du gouvernement dont elle faisait partie.
Polluants éternels : les députés tentent de faire aboutir la taxe anti-PFASDans le cadre de l’examen de la partie recettes du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, les députés ont approuvé ce 17 novembre une nouvelle écriture de la taxe "pollueur-payeur" sur les PFAS, la loi du 27 février dernier visant à protéger la population des risques liés à ces "polluants éternels" étant considérée comme inopérante selon plusieurs d'entre eux. Cette loi d'initiative écologiste prévoit notamment une redevance que doivent payer les industriels dont les usines rejettent des PFAS dans l'eau, de 100 euros pour cent grammes, à compter de 2026. Mais son application n'étant toujours pas entérinée, la députée Anne-Cécile Violland (Horizons, parti d'Édouard Philippe), a proposé un amendement au PLF pour réécrire la mesure, qui "ne permettait ni d'identifier clairement les redevables, ni de calculer l'assiette de manière fiable", a-t-elle argué. Elle a défendu "quatre améliorations essentielles, à savoir une clarification du périmètre des redevables ; une taxation des rejets nets réels de PFAS, permettant de garantir une redevance juste et proportionnée ; une assiette de taxation opérationnelle et contrôlable, qui sécurise la manière dont les redevables déterminent et déclarent leurs rejets (…) ; enfin, une indexation sur l’inflation". La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin (Renaissance) s'est dite favorable, estimant que la redevance était aujourd'hui "inapplicable" et "qu'il n'y a rien de pire pour la confiance démocratique". Mais un autre avis favorable de la ministre a divisé jusque dans son camp, lorsqu'elle a approuvé un amendement LR visant à repousser d'un an l'entrée en vigueur de la redevance, au 1er janvier 2027, pour préparer le dispositif et que les entreprises puissent s'adapter. Une position qui a irrité dans les rangs du groupe écologiste : "tous les mois de retard (...) c'est plus de personnes qui ont des cancers, des problèmes de fertilité et qui meurent", a lancé Marie-Charlotte Garin, députée du groupe Ecologiste et Social. Mais aussi Agnès Pannier-Runacher (Renaissance), ex-ministre de la Transition écologique : "il me semblait que quand j'ai quitté mon ministère, tout était prêt", a-t-elle pointé. Et les députés Renaissance, MoDem et Horizons ont majoritairement voté avec la gauche pour maintenir une application dès 2026. |


