ZAN : les enjeux intégrés, mais une mise en œuvre toujours contrariée, observe la Scet
De la quatrième édition du "baromètre ZAN" de la Scet, il ressort que les enjeux de la sobriété foncière sont désormais globalement bien assimilés par les acteurs de l'aménagement et de l'immobilier. Mais si la déclinaison du ZAN dans les documents d'urbanisme semble bien initiée, sa mise en œuvre concrète peine encore à se dessiner. Non sans raison, au vu de l'instabilité persistante du cadre réglementaire et de l'inertie du cadre financier et fiscal.
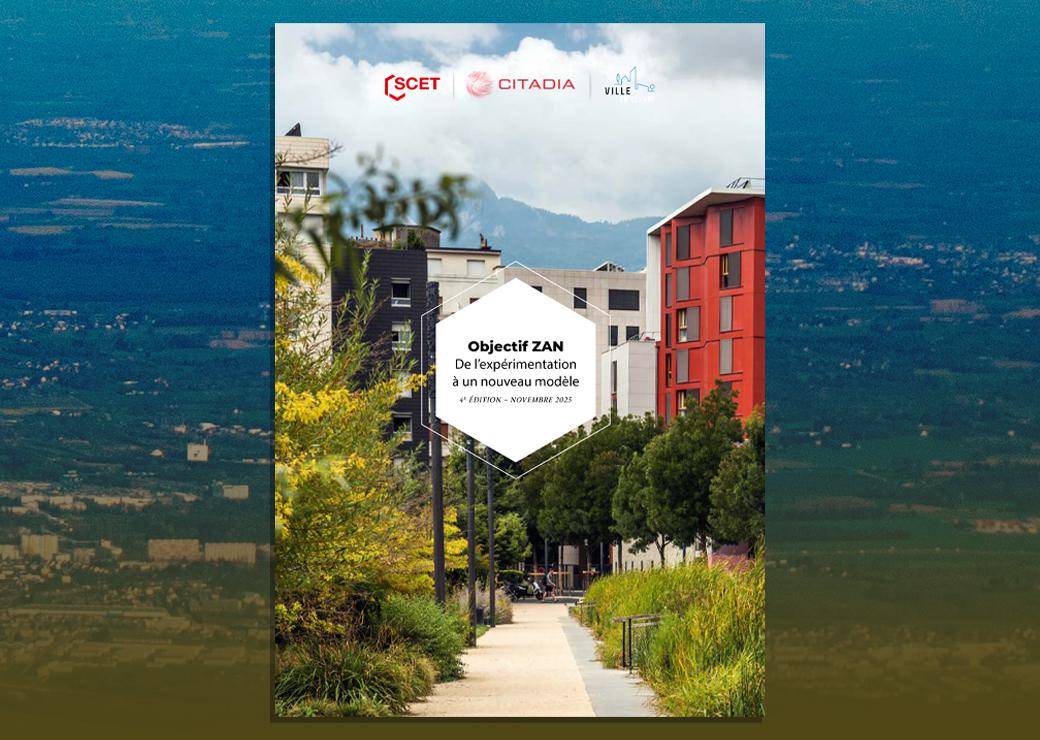
© Scet, Citadia, Ville en œuvre. Fond : Adobe stock
Récemment publiée, la quatrième édition du baromètre ZAN de la Scet confirme la teneur des débats tenus au Congrès de l'Association des maires de France (AMF) le 18 novembre dernier sur le sujet (lire notre article).
Des enjeux désormais intégrés
D'abord, le ZAN est en train d'être lentement digéré. 70% des personnes interrogées - 269 professionnels, dont 81% au sein de collectivités locales - considèrent désormais que les acteurs de l'aménagement et de l'immobilier ont pris conscience de ses enjeux. Que Sylvain Waserman, directeur général de l'Ademe, résume en une "réponse à deux évolutions : celle d'un modèle d'aménagement fondé sur l'étalement urbain désormais à bout de souffle, et celle de notre perception des sols comme une ressource précieuse et non renouvelable".
Ensuite, le défi reste dans sa mise en œuvre. Si pour 70% des répondants, la déclinaison des objectifs ZAN dans leur stratégie de développement territorial et leurs documents de planification a bien été lancée – "les collectivités se sont mises en mouvement […]. La machine, du côté planification, est engagée", salue Brigitte Bariol-Mathais, déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau) –, près de deux tiers d'entre eux (65%) ont l'impression que les actions mises en place restent insuffisantes. Un taux qui "se renforce d'année en année", constatent cette fois encore (lire notre article du 11 octobre 2024) les auteurs de l'étude, y voyant un "paradoxe". Il apparaît pourtant concevable que plus l'échéance approche, plus les craintes de ne pas être au rendez-vous aillent croissant, d'autant que plus de deux tiers des répondants estiment dans le même temps que l'expertise réglementaire, technique, financière des acteurs reste à parfaire.
Instabilité du cadre réglementaire
Et ce, là encore non sans raison, puisque les auteurs de l'étude soulignent eux-mêmes "la frénésie législative" toujours en cours dans ce domaine (comme dans d'autres), en mentionnant notamment les propositions de loi Trace (lire notre article du 19 mars 2025) d'une part, et celle "pour réussir la transition foncière" (lire notre article du 22 mai) d'autre part, qu'ils préconisent au passage d'examiner conjointement.
Difficile en effet de maîtriser un cadre réglementaire instable, que les auteurs jugent d'ailleurs "impératif de stabiliser à courte échéance". "On plaide pour qu'il y ait une vraie stabilité législative, parce que sinon cela alimente les incertitudes, l'attentisme et l'insécurité juridique", déclare de même Brigitte Bariol-Mathais. Un constat également dressé par Sylvain Waserman, lequel observe que les "processus longs" du recyclage foncier – et plus largement de "la sobriété foncière", dont il souligne qu'elle "implique un véritable changement de modèle", de "ne plus saisir les opportunités au fil de l'eau, mais de construire une stratégie" – se heurtent "à un cadre législatif ou financier instable, qui évolue rapidement".
Inertie du modèle économique et fiscal
Une dernière observation à laquelle on est toutefois tenté de mettre un bémol. Car en matière financière et fiscale, c'est davantage l'inertie qui pénalise, ce que reconnaît d'ailleurs le haut fonctionnaire en prônant "une indispensable évolution de notre modèle économique et fiscal". "On ne peut pas faire de la sobriété foncière à modèle [fiscal] constant", affirme à son tour Brigitte Bariol-Mathais. On ne sera donc pas surpris de constater que pour les personnes sondées (63%), le principal frein à la mise en œuvre du ZAN tient au manque de "soutenabilité financière des opérations d'aménagement". Et que les principaux outils qui font selon eux défaut pour atteindre l'objectif sont avant tout financiers (68% des répondants) et fiscaux (62%). Sylvain Waserman souligne que c'est particulièrement vrai "dans les zones où le foncier est encore relativement détendu", où "le recyclage foncier peine souvent à trouver un modèle économique viable". Une analyse confortée par l'étude, les répondants à l'enquête considérant que c'est sur "la revitalisation des territoires en perte de dynamisme que le ZAN a le moins d'emprise".
Péché originel de la loi Climat
In fine, l'étude n'est pas sans proposer, en creux, un bilan de la loi Climat & Résilience. À l'actif, "cette loi a eu le mérite de lancer une vraie prise de conscience et d'ouvrir le dialogue sur l'avenir de nos territoires", souligne Philippe Guyot, président du Grand Ouest toulousain et maire de Plaisance-du-Touch. Au passif, dressé par Brigitte Bariol-Mathais, "un manque d'expérimentation préalable", l'absence "d'étude d'impact", un "manque de prise en compte des spécificités géographiques et des dynamiques territoriales, comme la démographie", "un modèle totalement uniforme […] sur tout le territoire français", "une approche initiale très comptable", l'absence "d'outillage" des collectivités ou encore "une dimension de coopération peu poussée et travaillée". Autant d'éléments avec lesquels il faut, encore aujourd'hui, composer.
› Le défi de la qualité des solsAu-delà du "simple" défi de la "quantité", l'étude insiste à son tour sur la nécessaire "approche multidimensionnelle du sol" (qualité, fonctions écologiques, vulnérabilité et capacité de régénération, usages existants ou potentiels, dépendance aux réseaux), lequel est encore "trop fréquemment réduit à une simple surface". "Ne serait-ce que parce que, dans très peu de temps, va nous arriver une directive Sols [lire notre article du 6 juillet 2023] qui va traiter de la qualité et de la reconstruction de tous les sols", rappelle Brigitte Bariol-Mathais. "On ne pourra pas se limiter aux seules définitions d'espaces naturels et forestiers", précise-t-elle, ce qui nécessite de construire "tout un corpus de connaissance, d'outils et de références". Un nouveau défi pour lequel, souligne le directeur de l'Ademe, "de nombreuses collectivités, notamment les plus petites, disposent encore de ressources limitées" et devront donc être, là encore, accompagnées. Un défi qui doit, lui aussi, être pris en compte dans la stratégie foncière de la collectivité, insistent les auteurs de l'étude, à un moment où ils déplorent que la question foncière, bien que "devenue centrale", soit "encore trop traitée de manière fragmentée, ponctuelle ou en réaction à une opportunité d'aménagement". Laquelle stratégie ne peut elle-même "être qu'une déclinaison d'un projet de territoire d'ensemble", enseignent-ils. "Le projet de territoire fixe le cap ; la stratégie foncière trace le chemin". Un chemin assurément long et semé d'embûches. |


